
L’or blanc
Récit publié dans le N°32 – PRINTEMPS 2022 du magazine 200
Photographe: David Styv
En Amérique du Sud, le Chili long de 4200 kilomètres, regorge de trésors. La zone géographique de l’Atacama, longue de près de 1000 km pour 400 km de large, forme la pointe Nord du pays. Elle est gravée dans ma mémoire comme un lieu magmatique et fascinant que j’ai traversé plusieurs fois. Là-bas, on peut ressentir le bonheur ultime d’avoir l’impression d’être l’un des premiers humains à explorer un territoire à vélo tout en ayant accès à un terrain de jeu spectaculaire pour se tester sur des cols d’altitude sérieux tel que le paso JAMA (4 200m) ou explorer des pistes désertiques. Bien que cette quête soit illusoire, car de nombreux touristes internationaux ont foulé, pédalé et conduit sur les pistes du désert, elle m’a permis de trouver des prétextes pour retourner dans l’Atacama en 2021, accompagné de mon gravel afin d’y passer quelques jours de « repos » avant de m’engager sur la course d’ultracyclisme « Across Andes » dans le Sud du pays.
Le désert d’Atacama est l’un des endroits les plus secs de la planète, où certains disent qu’il n’a pas plu depuis plus de 50 ans. Ce no man’s land dispose d’une géographie singulière, coincée entre des paysages immémoriaux bruts et étonnants : la fosse d’Atacama dans l’est de l’océan Pacifique et la majestueuse Cordillère des Andes. C’est un véritable paradis (ou enfer) pour cyclistes où se mélangent volcans culminant à 6 000 m qui gardent la frontière entre le Chili et l’Argentine, lacs écarlates d’altitude, et déserts de sel, qui font l’objet de toutes les convoitises pour leur lithium. Une faune et une flore endémique survivent depuis des millénaires en observant les humains s’agiter. La dimension du désert peut donner le vertige et il est nécessaire de bien organiser sa logistique pour venir à vélo dans ce lieu reculé de l’Amérique du Sud.
L’oasis du désert
San Pedro de Atacama (2 500 m d’altitude) est un bon camp de base pour partir en migration ultralégère (bikepacking) ou en expédition avec des sacoches car le village est une porte d’entrée et de sortie desservie en bus. Contexte COVID oblige, c’est littéralement une expédition en soi pour rallier San Pedro depuis la capitale du Chili : Santiago. Deux trajets en bus de plus de 20 heures cumulées sont nécessaires et les négociations sont rudes pour pouvoir embarquer mon cheval de fer dans les soutes remplies de bagages et babioles. San Pedro a servi pendant de nombreuses années d’abri pour les âmes et les corps des bergers du passé et pour les voyageurs à vélo aventureux d’aujourd’hui. En arrivant sur place, les voyageurs sont absents, le village est calme, limite « fantomatique ». La majorité des sites touristiques environnants sont fermés au public à cause de la pandémie, à l’exception du « mirador piedra del Coyote » qui surplombe la majestueuse vallée de la Lune. J’en profite pour échanger longuement avec Janet, la propriétaire de « l’hostal Tehuel Aike » qui me partage ses inquiétudes depuis que le COVID a frappé la région.
Elle me raconte que le nom « Atacama » provient des Atacameños – les premiers habitants de cette terre hostile. Au cours des siècles, plusieurs civilisations ont survécu dans la région en exploitant ses ressources (céramique, fer, or, argent…) et par l’élevage de camélidés. Le calme actuel qui y règne à cause du COVID, tranche avec l’histoire tumultueuse de la zone qui fut l’objet de convoitises intenses et de rivalités territoriales fortes entre Chiliens, Boliviens et Argentins. Aujourd’hui encore, le murmure de ces rivalités bourdonne encore. Le désert n’aurait pas cette puissance symbolique si le calme que l’on y ressent lorsqu’on tente d’arracher quelques kilomètres à vélo dans cette zone, n’était pas brisé par les enjeux miniers qui se jouent dans cette région du monde lorsque l’on discute avec ses autochtones.
L’altitude ou la vie ?
Depuis ma modeste maison d’hôte, je fais le choix de tenter l’ascension vertigineuse du « Paso Jama » qui s’aborde bien plus sereinement en randonneuse qu’en gravel notamment pour l’autonomie matérielle nécessaire en cas de problèmes. Le COVID a frappé de plein fouet la région et les frontières demeurent fermées. Ce détail complique considérablement toute entreprise d’exploration du col. Jama est un passage frontière qui permet de rallier l’Argentine à l’est de San Pedro. Seul hic : il implique de franchir des altitudes périlleuses (4 836 m pour le point le plus haut) et la distance à parcourir jusqu’à l’Argentine en haute altitude est très importante (160 km). Compte tenu de mon équipement et de ma capacité de chargement limitée sur mon gravel, je planifie de revenir au camp de base de San Pedro le soir pour éviter les situations dangereuses que la haute altitude peut provoquer si je reste perché « dans les nuages » trop longtemps sans matériel. Les ravitaillements sont inexistants jusqu’à la frontière et les lacs d’altitudes impliquent l’usage d’un filtre dont je ne suis pas équipé. Heureusement, la nuit à San Pedro, il est possible de récupérer de ce « stage d’altitude », chaudement installé dans la maison d’hôte de Janet, tandis que la musique des bars encore ouverts, résonne discrètement au loin. En revanche, m’aventurer de nuit dans les environs en haute altitude ne fait pas rêver avec les températures qui s’effondrent vers les – 15 °C.
En partant plein Est en direction du « Paso Jama », j’approche du majestueux Licancabur (« montagne du peuple » dans la langue Kunza des Atacameños). C’est le gardien de la région du haut de ses 5 916 m et il agit tel un poumon terrestre dissimulant un réseau souterrain magmatique invisible. Le col de Jama est d’une violence cycliste extrême avec ses 55 km d’ascension « non-stop » qui permettent de passer de 2 500 m d’altitude à 4 800 m. De loin en quittant San Pedro, il m’est impossible de déterminer où se trouve son sommet. Ce territoire est tellement délirant visuellement que l’échelle des choses disparaît. Impossible de réaliser que le Licancabur culmine si haut dans le ciel. Impossible d’imaginer que ce col va nécessiter toutes mes tripes quand je tente son ascension. En réalité, après avoir regardé attentivement les chiffres, il s’agit d’une des ascensions les plus longues du monde car on ne commence réellement à descendre sous les 4 000 m qu’après 225 km parcourus depuis San Pedro ! La tentation de franchir ces paliers d’altitude en une seule journée est grande mais le rappel à l’ordre de mon corps est immédiat. Jusqu’à 4 000 m, tout va bien. Au-delà, par expérience, les ennuis arrivent avec la sensation d’asphyxie que provoque l’altitude. Une respiration profonde est indispensable pour reprendre son souffle. Cette action si simple en apparence : respirer, me fait suffoquer là-haut. J’ai passé plusieurs semaines dans ma vie en haute altitude, mais rien n’y fait, le corps hurle quand même à chaque fois. Avec 40% d’oxygène en moins par rapport au niveau de la mer, mon corps fait sauter tous les plombs comme à l’accoutumée : la vue, l’ouïe, l’odorat, le goût, tout semble s’évanouir. A 140 pulsations par minute, mon capteur de puissance indique un chiffre dérisoire. L’effort ressenti à vélo ressemble à un sprint, pourtant je grimpe à 6 km/h, debout sur les pédales. C’est dans ces conditions que la magie de l’altitude opère. Je m’asphyxie pendant de longues minutes en attendant que le corps et l’esprit se calibrent. Tels des pendules asynchrones d’une même horloge, lentement ils ralentissent, leurs rythmes s’évanouissent progressivement. Puis un miracle se produit : corps et esprit renaissent de concert. L’eau est un ingrédient essentiel en altitude qui peut trahir même les personnes les plus expérimentées. La sensation de soif disparaît tout simplement. Je force donc l’absorption de quelques gouttes du précieux liquide en programmant une alarme dans mon GPS qui me rappelle de boire régulièrement. Le lac de « Aguas calientes » (les eaux chaudes) perché à 4 240 m est le point le plus à l’est que je parviens à rallier avant de rebrousser chemin vers « la plaine » jusqu’à San Pedro.
J’aime m’essouffler et m’épuiser dans les pays à l’oxygène rare, la vie n’est que plus belle quand on redescend dans les plaines pour reprendre son souffle. L’apnée volontaire qu’implique la pratique de la haute altitude à vélo est une expérience en soi. Elle vient ajouter un sentiment particulier qui vient balayer tous les repères habituels du cycliste. La distance, le dénivelé total ne comptent plus. Gravir lentement, tel un pèlerin durant une procession, une montagne en altitude, est un défi inouï. Quelle que soit sa condition physique, la montagne seule, fait le choix de nous laisser la dompter ou pas. Le « mal aigu des montagnes » (MAL) peut frapper à tout moment et imposer une redescente dans la plaine pour récupérer des forces. Une vie humaine c’est environ 775 millions de respirations. En haute altitude à vélo, on apprend à les compter une à une et à les chérir comme s’il s’agissait des dernières. Le col de JAMA me rappelle ceci : j’aime cette incertitude, cette possibilité que peut-être, le sommet ne sera pas pour aujourd’hui. Cela replace l’Homme dans le rapport de forces qui se doit d’exister pour respecter l’ordre des choses entre la Nature et lui-même. L’humain est de passage, la Nature est une sauvage immortelle.
Le lithium de l’Atacama
Après avoir récupéré mon souffle (et mes jambes), je tente de mieux comprendre avec Janet, mon hôte, l’histoire du Salar d’Atacama, pour tenter de le traverser à vélo. C’est le désert de sel le plus grand du pays. Il fait partie du « triangle du lithium » dans lequel se concentrent plus de 20% des ressources planétaires actuellement découvertes. A titre d’information, une voiture « Tesla », c’est 10 000 téléphones portables, et leur carburant vient pour partie de la région de l’Atacama. Le précieux « or blanc » est sur toutes les lèvres dans le Nord Chili, on le lit sur des tags sur les poteaux électriques, sur des pancartes de propagande à l’entrée de San Pedro ou dans les bars. En quelques minutes de conversation, Janet m’apprend que les mines de l’Atacama sont gérées principalement par les sociétés SQM et Albertmarle, les deux géants mondiaux qui se partagent le lithium de notre planète.
Je m’élance en gravel pour tenter de traverser le désert de sel situé à une quarantaine de kilomètres de San Pedro. Rien à voir avec l’image stéréotypée des étendues blanches de carte postale qui représentent généralement le Salar d’Uyuni en Bolivie. Le salar d’Atacama (300 000 ha) est trois fois plus petit que son frère bolivien. Le lieu est nettement moins touristique et rares sont les individus qui peuvent pénétrer facilement dans le désert. Les pistes sont cabossées et même en 4×4, la croûte solide de sel à sa surface peut annihiler la volonté de n’importe quel conducteur qui ne connaît pas les lieux. Mon gravel se dandine dans les ornières de sable, il fait 47°C au soleil sans un arbre à l’horizon. Le pédalier craque, les pneus jubilent, cette folie laissera des traces inoubliables pour les moyeux de mes roues. Le sable forme une douve naturelle à franchir pour rejoindre la forteresse des mines que j’aperçois au loin tels des mirages qui vacillent avec la réfraction de la lumière à l’horizon.
Singularité propre au salar de l’Atacama, quelques rares espèces végétales survivent dans cet univers apocalyptique. En pédalant, je me croirai presque en Camargue avec des champs de sansouïres. Le paysage est figé, quelle que soit la vitesse atteinte. Je pédale comme un dératé et rien ne bouge. J’observe les montagnes, les volcans, les coulées tout autour de moi qui ressemblent à des strates de la croûte terrestre à vif. L’activité sismique a débuté il y a 10 millions d’années dans la zone et le tableau naturel est saisissant par sa magnitude. Le sel du salar est intimement connecté aux volcans voisins. En période de pluie, les sommets enneigés de la chaine andine font s’infiltrer puis ruisseler en souterrain de l’eau qui se charge alors en sel. Le salar qui fait office de « réservoir » fait remonter par un phénomène d’affleurement l’eau qui s’évapore et laisse les sels minéraux s’accumuler en croûte à sa surface.
Un panneau d’interdiction vient bloquer la seule piste pour traverser le salar en direction des mines. Aucune alternative n’existe à part celle de pousser mon vélo dans le sable pendant 70 kilomètres pour les rallier. Comme tout or, l’exploitation de « l’or blanc » est bien protégée. Malgré mes sollicitations pour satisfaire ma curiosité, SQM refuse mon approche du désert à vélo et je préfère rebrousser chemin. Les infrastructures changent, d’ici 4 ans une autoroute devrait remplacer la piste sur laquelle je pédale et permettre de connecter le désert à la ville portuaire d’Antofagasta sur la côte ouest du pays afin d’accélérer l’exploitation des minerais de la région. L’asphalte a remplacé les pistes sur lesquelles j’avais pédalé il y a quelques années. Le même destin attend la piste qui longe le salar d’Atacama sur laquelle je pédale aujourd’hui. L’humain continue de construire ses forteresses dans la région avec l’aide massive des capitaux chinois pour vider les sols de leur substance et assécher les rares ressources aquatiques de la région. Ce nouveau pétrole régional, le lithium, fait tourner les têtes et je prends conscience de la chance que j’ai de revenir depuis quelques années poser mes roues ici pour aller m’asphyxier dans les hauteurs avant que ne vrombissent les machines qui asphaltent le secteur à tout va.
Le condor fait des cercles au-dessus de ces bandes noires d’asphaltes que l’homme tatoue sur le sol sans que ce dernier ne se rende compte du corps herculéen sur lequel il applique son aiguille. Car s’il y a bien un lieu sur la planète où l’écho de la puissance terrestre peut être écouté, c’est bien l’Atacama. Au moment où j’écris ces lignes, les frontières humaines terrestres demeurent fermées avec la Bolivie et l’Argentine. Le commerce régional des produits et babioles, lui, est ouvert. Les routiers que je croise à vélo durant mes quelques jours passés dans l’Atacama me saluent d’un coup de klaxon ou d’un signe de la main. Comme moi, ils sont bloqués à la frontière où ils déposent leurs marchandises qui sont ensuite récupérées par un autre routier argentin afin d’être convoyées à bon port.
La note positive de ces restrictions imposées par le contexte COVID : elles me donnent un prétexte futur de revenir encore car je rêve de pouvoir connecter le Chili et l’Argentine sur les 5 308 km de leur frontière. Chaque passage frontalier de la cordillère des Andes entre ces deux pays est, paraît-il, somptueux. Au rythme où vont les choses, il me faudra sans doute toute une vie pour réussir cette entreprise. Espérons simplement que l’homme n’aura pas tout asphalté d’ici là ou pire, tout interdit.
Récit publié dans le N°32 – PRINTEMPS 2022 du magazine 200
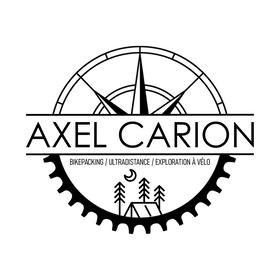











Stéphane
Superbe article qui me rappelle un moment fantastique mais dur de notre chevauchée de L’or blanc bolivien en randonneuse lors de Biketrippers en 2015! Avec rappels toi le volcan qui rugissait et nous éclairait la nuit avec son feu d’artifice rouge !
Love
Stef
Yannick B.
J’apprécie beaucoup ton écriture. Tu devrais penser à écrire un livre, agrémenté de tes photographies, sur tes expéditions …
axel
Merci Yannick j’espère que cette idée pourra se concrétiser prochainement 🙂